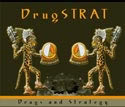Les drogues en Afrique australe : les affaires continuent
Revue Internationale des Sciences Sociales, "Le trafic international des drogues : Dimensions économiques et sociales", n° 169, Septembre 2001 (UNESCO)
Résumé
Les années 1990 ont vu une Afrique australe plus pacifique s'ouvrir au monde et devenir une plaque tournante et un marché pour les flux internationaux de drogues illicites. Une situation paradoxale, semble-t-il, étant donné que le phénomène de la drogue, surtout dans les régions en développement, est habituellement attribué à des circonstances exceptionnelles : guerre, absence d'État de droit ou, au contraire, règne d'une dictature ou d'un autre régime d'oppression. Comment expliquer que cette explosion des activités liées à la drogue survienne après la période de "normalisation" qui a permis à l'Afrique australe de rallier le mouvement de "mondialisation" et non lorsqu'elle était la proie d'un racisme et d'une guerre érigés en institutions ? Le présent article tente de fournir des éléments de réponse en suggérant qu'à l'heure actuelle ces activités soient l'un des modes d'expression et de reproduction des mécanismes historiques, politiques, sociaux et économiques majeurs qui interviennent au sein de l'Afrique australe et entre cette région et le reste du monde.
Introduction
En s'ouvrant au monde au cours des années 1990, l'Afrique australe [1] pacifiée est devenue une plaque tournante et un marché pour les flux internationaux de drogues illégales, cocaïne, héroïne, hachisch et "drogues de boîtes de nuit" ("club drugs"), principalement ecstasy et LSD. Elle a aussi commencé à exporter une marijuana locale, même s'il ne s'agissait que de faibles volumes, les marchés locaux absorbant presque tout le cannabis produit dans la région [2] . Cette explosion manifeste des activités liées à la drogue pourrait être, en partie, un artefact du changement d'optique des services locaux et internationaux de répression qui se sont montrés plus désireux de placer la région pacifiée sous surveillance. Nul doute néanmoins que le commerce et la consommation de drogues y sont alors plus importants qu'auparavant. En 1995, année où les statistiques relatives à l'Afrique, habituellement fragmentaires, sont presque complètes, environ 50 % des saisies totales d'héroïne sur le continent ont eu lieu en Afrique australe. De plus, près de 9 % de la marijuana et 48 % de la méthaqualone (connue localement sous le nom de "Mandrax") saisies dans le monde entier ont été confisquées dans cette région. Même si les interceptions de cocaïne étaient faibles en Afrique au milieu des années 1990 (elles ont sensiblement augmenté depuis), en 1995, 73 % de ces saisies concernaient l'Afrique australe [3] .
Cette situation paraît paradoxale, étant donné que le phénomène de la drogue, surtout dans les pays en développement, est en général attribué à des circonstances exceptionnelles : guerre, absence d'Etat de droit ou, au contraire, règne d'une dictature ou d'un autre régime d'oppression. Toutefois, la fin de la période de l'apartheid et de la guerre froide a entraîné l'arrêt de la plupart des opérations militaires et des luttes de guérilla de grande envergure dont l'Afrique australe était le théàtre et l'embargo international contre la RSA a été levé. Les relations commerciales, diplomatiques, culturelles et politiques entre cette région et le reste du monde, qui étaient limitées voire secrètes (en violation des résolutions de l'ONU) au temps des conflits, se sont normalisées. En Afrique du Sud proprement dite, chef de file économique et politique de la région et enjeu final de la plupart des affrontements, la paix a instauré un gouvernement démocratiquement élu qui jouit d'un ferme soutien intérieur et international et d'une grande légitimité.
Et pourtant, la croissance des activités illégales, y compris en matière de drogues, et la violence qui y est associée, ont fait naître une telle inquiétude dans cette nouvelle Afrique du Sud que ses dirigeants ont fait appel à l'aide des Etats-Unis pour les combattre (National Crime Prevention Strategy 1996). Comment expliquer que ce boom des activités liées à la drogue survienne après la "normalisation" qui a permis à l'Afrique australe de rallier le mouvement tant vanté de la "mondialisation" plutôt qu'à l'époque où elle était la proie d'un racisme et d'une guerre institutionnalisés ?
Le présent article tente de fournir des éléments de réponse en suggérant qu'à l'heure actuelle ces activités sont l'un des modes d'expression et de reproduction des mécanismes historiques, politiques, sociaux et économiques majeurs qui interviennent en Afrique australe et entre cette région et le reste du monde.
Le phénomène de la drogue est un tissu complexe d'activités sociales, notamment production, transfert et consommation de drogues psychotropes illicites, blanchiment d'argent et contrôle exercé par les organismes gouvernementaux. Il s'accompagne aussi de représentations ou significations collectives associées aux drogues. Les activités humaines s'exercent dans des contextes géographiques et historiques qui modèlent les milieux politiques, économiques, culturels et psychologiques, en particulier les représentations et les stratégies des acteurs sociaux – individus, groupes et organisations (cultivateurs, forces de police, banques et mafias) – engagés dans les trafics de drogues et expliquent, dans l'ensemble, la forme et la nature des activités liées aux stupéfiants et ce à quoi elles aboutissent, y compris leurs conséquences sur la société [4] .
Les choses se compliquent encore du fait que la mise en oeuvre de certaines de ces activités (trafic, blanchiment, etc.) peut intervenir dans plusieurs milieux, faire appel à divers acteurs sociaux situés dans différentes régions du monde, à l'aide de certaines combinaisons distinctes de ressources politiques, sociales, culturelles et de capitaux, et ce pour différents enjeux. Ensuite, les conséquences du phénomène de la drogue viennent à leur tour façonner les contextes et les acteurs. On se trouve ainsi en présence d'un processus dynamique d'interaction au sein duquel s'exercent des courants mutuels d'influences et de contraintes entre contextes, acteurs et drogues – aucun ne pouvant s'expliquer indépendamment des autres.
En bonne logique, la recherche devrait faire apparaître tous les processus complexes, ambigus et imbriqués mis en jeu par les rencontres multidimensionnelles d'un large éventail d'acteurs sociaux qui évoluent dans une gamme étendue de milieux entremêlés et passent de l'un à l'autre. Toutefois, en raison des limites imposées par la brièveté du présent article et du peu de données empiriques sur lesquelles il se fonde, seuls quelques processus ayant trait au problème de la drogue en Afrique australe font ici l'objet d'une analyse succincte [5] .
Dans la première section, l'auteur se concentre sur le contexte planétaire actuel et tente d'identifier trois facteurs importants qui contribuent à expliquer le phénomène de la drogue en Afrique australe. Dans la deuxième, il examine un élément interne essentiel en Afrique australe - le clivage "ethnique" - afin d'éclairer quelques processus et représentations des stupéfiants propres à ces sociétés. Enfin, la troisième section est consacrée à l'analyse d'un mode d'interaction important au sein de l'Afrique australe et entre la région et le reste du monde – le troc – et montre que les drogues sont devenues des monnaies internationales.
Le contexte planétaire
Au cours des années 1990, l'Afrique australe s'est ouverte à un monde qui n'était plus celui dont des sanctions internationales l'avaient peu à peu écartée au cours des précédentes décennies. La logique bipolaire de la guerre froide dans laquelle s'inscrivaient les conflits régionaux avait cédé la place à l'ère de la "mondialisation" et il ne restait plus qu'une seule superpuissance : les Etats-Unis. Trois traits caractéristiques du "village planétaire" sont au cœur de la question qui nous occupe, même si l'abondante littérature parue sur la mondialisation en fait rarement état.
(a) La "prohibition répressive" est inspirée et conduite par les Etats-Unis mais bénéficie d'un large consensus. Il s'agit d'un système mondial de prohibition de la drogue, visant à la suppression totale de certaines plantes et substances (principalement au moyen de contrôles de police), en vigueur dans la plupart des Etats depuis 1945. Il a atteint son apogée lors de la signature, en 1988, de la Convention de Vienne des Nations Unies, qui a ensuite été peu à peu introduite dans les législations nationales du monde entier. La plupart des Etats étaient parties à la Convention de Vienne. La prohibition répressive est un trait distinctif du phénomène moderne de la drogue. Les conséquences sont récurrentes et deux d'entre elles paraissent fondamentales. En premier lieu, le trafic de certaines drogues devient extrêmement rentable – bien plus que la plupart des activités légales exercées dans le monde entier. En second lieu, à de rares exceptions près, la prohibition mondiale est à l'origine du caractère clandestin des activités liées à la drogue et de leur association à plus de violence que les activités légales. Il est probable que les énormes profits et la violence inhérents à la prohibition sont, à l'heure actuelle, les conséquences les plus graves et les plus directes du phénomène de la drogue.
(b) Parallèlement à l'accession à l'hégémonie de la soi-disant idéologie de la libre entreprise, le néolibéralisme économique enregistre de mauvais résultats dans la plupart des régions du monde. Cette situation a entraîné, entre autres, la privatisation d'avoirs de l'Etat, une dépendance accrue à l'égard des marchés internationaux au détriment des mécanismes nationaux de production, un chômage et un sous-emploi structurels, joints à une raréfaction des politiques de redistribution et des programmes sociaux. Il en est progressivement résulté une répartition inégale des richesses et du revenu, tant au sein des pays qu'entre les nations, et l'appàt du gain semble être devenu en définitive l'objectif de la plupart des activités humaines. Ainsi, les couches sociales les plus pauvres ont été davantage incitées à se tourner, pour assurer leur survie ou améliorer leur condition, vers des activités prédatrices, des trafics parallèles "informels". Dans le même temps, des personnes faisant partie de l'élite ont investi dans des activités illicites, notamment le trafic de drogues, pour essayer de remédier au fait qu'elles ne pouvaient plus puiser dans des caisses de l'Etat qui rétrécissaient comme une peau de chagrin. Quant aux élites politiques, elles se sont lancées dans des activités criminelles pour continuer de financer de vastes réseaux clientélistes alimentés auparavant par des fonds publics détournés, désormais moins accessibles en raison des privatisations. L'élite ayant la haute main sur les systèmes judiciaires nationaux et le soutien de partenaires de l'étranger, jusqu'à présent l'impunité est garantie, dans une large mesure, tandis que la corruption et les troubles sociaux s'étendent et que l'autorité et la légitimité de l'Etat s'affaiblissent. Particulièrement flagrante en Afrique, cette dérive ne se limite pas à ce continent (Bayart et al. 1997).
(c) L'explosion de la production de drogues dans le monde entier depuis le milieu des années 1980, en particulier de l'opium et des feuilles de coca, matières premières de l'héroïne et de la cocaïne. Selon les estimations de l'ONU, en Afghanistan la production d'opium a quadruplé de 1985 à 1995, passant de 500 à 2.000 tonnes (PNUCID 1997 : 20). En 1999, quelque 4.581 tonnes d'opium ont été récoltées dans ce pays qui est le plus grand producteur d'opium du monde (OGD 2000 : 52) [6] . La Birmanie, dont la production était évaluée en 1999 à 1.200 tonnes (2.500 tonnes en 1998), occupe la deuxième place (OGD 2000 : 16). On peut obtenir environ 100 kg d'héroïne avec une tonne d'opium. L'Afghanistan et la Birmanie sont les plus grands exportateurs d'héroïne du monde. Par ailleurs, la production totale de feuilles de coca des pays de la région andine a plus que doublé de 1985 à 1995 et on estime que 300.000 tonnes de feuilles de coca ont été récoltées en 1996, ce qui représente un potentiel de production de 1.000 tonnes de cocaïne (PNUCID 1997 : 18). Ces énormes stocks d'opiacées et de cocaïne, ajoutés à des productions aussi importantes de cannabis et de (meth)amphétamine, de "club drugs" et d'autres substances, attestent, pour le moment, le lamentable échec du système actuel de répression par rapport à l'objectif qu'il s'était fixé. Cette situation a surtout pour conséquence de créer, à l'échelle de la planète, une "pression de l'offre" qui, conjuguée à d'autres facteurs, entraîne une croissance rapide et régulière de la consommation de drogue, notamment dans le monde en développement. Afin d'alimenter ce marché, une infinité de routes et de méthodes de trafic nouvelles, "alternatives" se sont ajoutées aux filières traditionnelles et sont venues grossir les quantités d'argent de la drogue en quête d'un appareil de blanchiment. Un tel processus est favorisé par le développement des échanges, transports et transactions financières associés à la mondialisation (Keh et Farrel, 1997) et par le retranchement beaucoup moins visible des capitaux de la drogue, dans le monde entier, derrière un investissement dans des activités licites, ce qui facilite le blanchiment et confère une respectabilité de façade.
Clivages "ethniques"
Les facteurs de portée mondiale sont certes importants pour comprendre le phénomène de la drogue à l'époque moderne, mais ils ne rendent compte que d'une partie de la situation. Le reste se joue à l'échelle des contextes locaux qui se combinent et interagissent avec le contexte planétaire. En effet, les drogues sont des objets palpables, matériels qui doivent être situés quelque part. Il n'en va pas des drogues comme de l'argent : on ne peut les manipuler en cliquant sur un écran d'ordinateur. Les drogues sont également liées aux acteurs qui les produisent, les transportent, les utilisent et mènent une réflexion à leur sujet ainsi qu'aux sociétés dont ces acteurs sont issus.
En ce qui concerne l'Afrique australe, l'un des facteurs qui influence le plus le phénomène de la drogue est le concept relationnel complexe et mouvant d'"ethnicité". Les sociétés sud-africaines se considèrent en effet, semble t-il, comme composées de communautés ethniques distinctes qui vivent côte à côte mais ne se mélangent pas. La perception de ces clivages ethniques découle d'une longue histoire de migrations et de conquêtes - notamment la colonisation - et de ségrégations officielle (politique) et non officielle (socio-économique) qui ont forgé des représentations de soi et de l'autre. A cet égard, le passé récent a laissé une marque particulièrement profonde. Jusqu'au début des années 1990, certains gouvernements de la région se sont ouvertement réclamés de différences ethniques pour pérenniser les systèmes de répartition inégale des terres et autres ressources, privilégiant ainsi une communauté par rapport aux autres.
Institutionnalisé par la République sud-africaine, le régime de l'apartheid a conditionné l'existence de la population sous toutes ses formes. La ségrégation socio-économique selon l'origine ethnique appliquée par les "Blancs", qui dirigeaient l'Etat, s'est traduite dans le domaine de la politique par la lutte organisée contre le système des "Noirs" et des "Métis", privés de leur droit de représentation [7] . Des forces analogues étaient à l’œuvre en Rhodésie, devenue le Zimbabwe, dans "l'Afrique du Sud-Ouest", aujourd'hui la Namibie, et dans les colonies portugaises de l'Angola et du Mozambique [8] . Ainsi, la ligne de démarcation entre les spécificités culturelles, socio-économiques et politiques s'est quelque peu estompée dans ce qu'on l'on pourrait appeler une version vécue de "The Clash of Civilizations", l'agenda proposé par Huntington pour l'élaboration des plans stratégiques des Etats-Unis au XXIe siècle (Huntington, 1993). Par ailleurs, les luttes régionales qu'a connues l'Afrique du Sud ont renforcé les barrières entre communautés et suscité défiance, haine et violence. Cette guerre, qui se déroule dans un environnement où des communautés ségréguées ont souvent trouvé un appui auprès de leurs diasporas et de réseaux clandestins et ont d÷ recourir à des stratégies de survie, a ancré plus avant dans les esprits l'idée selon laquelle "les autres" - les membres d'un autre groupe ethnique, d'une autre organisation politique ou l'Etat - sont un obstacle à leur développement personnel, voire un ennemi.
La peur des "autres" et la méfiance à leur égard, alliées à l'afflux soudain de drogues d'importation semblent avoir structuré de nouveaux rôles sociaux de boucs émissaires. Plus l'établissement d'une communauté dans la région est récent, plus celle-ci risque d'être accusée de trafic de drogue. L'arrivée simultanée d'émigrants et de drogues a généré une nouvelle croyance populaire locale qui associe telle drogue à une certaine communauté. Même si ces perceptions se fondent parfois sur des faits, elles font supporter à un groupe ethnique tout entier la responsabilité d'activités en matière de drogues qui sont imputables à quelques individus. Cette situation influe particulièrement sur la façon dont les lois sur les stupéfiants sont appliquées en Afrique australe. La répression est une activité sociale complexe et, en tant que telle, elle ne peut être isolée du milieu dans lequel elle intervient.
Dans une interview officielle, un officier de police du Lesotho, petit pays enclavé peuplé presque exclusivement de l'ethnie Basothos, a été jusqu'à refuser d'admettre, malgré des preuves indéniables du contraire, que ses compatriotes avaient le moindre lien avec le trafic de drogue et il a affirmé que ce problème s'est posé après "l'ouverture des frontières aux étrangers". Il a ainsi accusé les Sud-Africains d'être à l'origine de la culture du cannabis au Lesotho et les Nigérians d'être responsables de la hausse de la consommation locale de cocaïne (bien qu'encore limitée) et aussi des "club drugs" (pour lesquelles il est hautement improbable que les Nigérians aient la moindre responsabilité). De même, la communauté indienne a été soupçonnée de se livrer au trafic de Mandrax et les Chinois d'importer des amphétamines. Des observations analogues ont été faites au Swaziland et au Zimbabwe.
Dans toute l'Afrique australe les "Nigérians" ou des Africains de l'Ouest qualifiés de Nigérians sont les boucs émissaires favoris de tous, et en particulier de la police. On attribue en grande partie cette situation à la mauvaise réputation internationale du Nigéria, considéré comme un repaire de trafiquants de drogue. Un fonctionnaire afrikaner du South African Narcotics Bureau (SANAB), interviewé au cours d'un raid antidrogue assez brutal dans le quartier de Hillbrow et Berea de Johannesburg (surnommé "Petite Lagos"), a fait une déclaration qui résume le sentiment général : On dit que plus de 80 % des trafiquants viennent du Nigéria. Cela ne peut être qu'eux, qui d'autre ? Lorsque l'Afrique du Sud s'est ouverte au reste du monde, ce sont les Nigérians qui ont introduit les drogues. (Amupadhi et Commandeur, 1997).
En 1993, les "Nigérians" ont été accusés d'importer plus de 50 % de la cocaïne interceptée en République sud-africaine. Environ deux tiers des immigrants illégaux qui purgent une peine de prison en Afrique du Sud sont des "Nigérians". Malgré ces nombreuses incarcérations, il est toujours facile de se procurer de la cocaïne et du crack dans le pays, et si les trafiquants nigérians importent et distribuent effectivement ces substances en Afrique du Sud et ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Mais en tant qu'"outsiders" politiquement et socialement neutres, privés de toute forme de "capitaux protecteurs" localement valables, ils sont devenus des cibles commodes pour la police, elle-même influencée par l'image sociale négative des "Nigérians" qui prévaut actuellement dans les sociétés d'Afrique australe.
Le deuxième groupe de boucs émissaires le plus prisé dans la région, notamment parmi les policiers d'origine ethnique africaine, est constitué par une population indienne et chinoise. Les communautés indiennes et chinoises, présentes dans toute l'Afrique australe, sont surtout engagées dans le commerce et les affaires et sont en général rejetées par les Africains. En revanche, à Maurice, où la plupart des hommes politiques et des fonctionnaires sont d'origine indienne, presque tous les individus arrêtés pour usage de drogue et petite délinquance sont Créoles (c'est-à-dire des Noirs), et pauvres.
Alors que des communautés entières sont la cible de la police parce que certains de leurs membres sont connus pour participer à des activités liées à la drogue ou suspectés de le faire, des trafiquants appartenant à d'autres communautés non "suspectes" sont plus libres d'agir. En raison de l'impunité relative dont jouissent les trafiquants de certaines origines ethniques, des personnes appartenant à des communautés traquées ou extrêmement démunies considèrent la police comme une force d'oppression et se refusent à toute coopération. Nombre d'entre elles se livrent à des "activités criminelles" pour contrebalancer l'inégalité des ressources qui, pour elles, est héritée de l'apartheid. Un trafiquant de diamants Ovambo, anciennement combattant de la liberté, a déclaré à l'auteur du présent article que "voler les gros producteurs de diamants" ne lui posait pas de problème d'ordre moral ; "ces sociétés sont la propriété de riches Blancs qui ont volé la terre de mes ancêtres et [ont prospéré] gràce à l'apartheid, et moi j'ai une famille à nourrir". En Afrique du Sud, les non-Blancs désignent souvent ceux qui détenaient le pouvoir politique sous le régime de l'apartheid et conservent aujourd'hui une grande partie de la puissance économique et administrative sous l'appellation de Boere Mafia, considérant ainsi que leur union paraît cimentée par leur origine ethnique et leurs activités criminelles. Ces Afrikaners se recrutent principalement parmi les officiers du SANAB, connus pour leur grande corruption.
En Afrique australe, le phénomène de la drogue est dominé, semble-t-il, par un principe inspiré du mot célèbre de Sartre : "la drogue, c'est les autres". Le brusque développement du commerce de la drogue est perçu, à juste titre, comme la conséquence directe de l'ouverture récente des sociétés régionales à l'influence non dissimulée du monde extérieur. Les sociétés d'Afrique australe ont non seulement importé les drogues mais aussi la représentation des drogues en tant que mal absolu, qu'elles ont rapidement intégrée et ont traduite pour ainsi dire dans leur propre "grammaire sociale", où les clivages ethniques occupent une place centrale. Il y aurait ainsi deux symboles distincts du mal, l'un relativement nouveau - les drogues -, qui semble avoir un caractère plus exogène, et un symbole plus ancien et plus enraciné dans les croyances locales – "l'autre", celui qui appartient à une ethnie dangereuse – lesquels se sont fondus en une seule représentation syncrétique du mal.
Il semble donc, dans une certaine mesure, que la répression en matière de drogues reproduise aujourd'hui certaines des caractéristiques de l'apartheid. Si cette tendance venait à se confirmer, l'action menée dans le domaine de la drogue pourrait bientôt devenir un succédané de la discrimination ethnique - un moyen de perpétuer des préjugés alors que le racisme déclaré est devenu politiquement incorrect. Cet état de fait, surtout en Afrique du Sud, évoque la situation qui prévaut aux Etats-Unis, où la grande majorité des individus emprisonnés pour infractions en matière de drogues viennent des communautés noires et latino-américaines, qui sont les plus pauvres du pays.
Le troc : les drogues en tant que "monnaie"
Une des caractéristiques du commerce de la drogue en Afrique du Sud est le troc, méthode utilisée depuis toujours pour échanger des marchandises. En fait, nombre de trafics y prennent la forme d'un échange de produits ou de services locaux contre de la drogue. Dans cette région où abondent trafics illicites et tendances inflationnistes, mais où l'argent liquide fait défaut, où aucune monnaie nationale, sauf le rand sud-africain, n'est convertible, des substances telles que la marijuana, le Mandrax, l'héroïne et la cocaïne servent parfois de moyens de paiement pour d'autres marchandises, licites ou illicites. Comme dans l'Amazonie brésilienne (Geffray 1996), le troc est, au niveau macro-économique, un facteur déterminant de la diffusion de la drogue en Afrique australe.
Les drogues illicites comptent aujourd'hui au nombre des produits échangés par quelques-uns au moins des réseaux qui gèrent des flux (de marchandises licites ou illicites) de grande valeur à destination ou en provenance de l'Afrique australe. Il est assez logique que les drogues puissent jouer le rôle de "devises fortes" : peu co÷teuses à la production, elles se vendent très cher et ne sont pas soumises à l'inflation (la prohibition maintient des prix plancher et réglemente la surproduction) ; assez faciles à transporter, en raison de leur faible volume, elles sont soit écoulées en échange d'argent ou d'autres produits sur un marché régional en expansion, soit utilisées dans le cadre d'autres transactions régionales ou internationales. Ce sont des marchandises souples à forte valeur ajoutée, qu'il est aisé de se procurer et d'écouler sur le marché mondial à condition d'avoir les contacts voulus. Par le biais d'accords de troc, les vendeurs de drogue écoulent leur marchandise mais de surcroît, ils blanchissent de l'argent. Les drogues ont des avantages comparatifs à condition que les acteurs se montrent capables de contourner ou de surmonter les forces de répression, ce qui donne à penser que le trafic des drogues est fortement tributaire d'un "capital de protection" garantissant l'impunité à ses protagonistes.
Les drogues font désormais partie d'une dynamique régionale fondée sur les armes et les marchandises volées, en particulier les automobiles et le bétail. Le trafic se développe dans la région en se rattachant à des activités prédatrices illicites très localisées, dont l'exécution repose souvent sur l'emploi des armes.
Ainsi, une pratique apparue initialement à la fin des années 1980, s'est considérablement étendue depuis le milieu des années 1990 : le troc de véhicules ou de bétail volés contre de la drogue ou des armes. Comme l'explique S. Ellis, dans le cas de l'Afrique du Sud : "A l'échelon local, les milices armées et les gangs essaient de prendre le contrôle d'une parcelle de territoire pour en tirer profit. Certains d'entre eux [...] forgent des alliances avec des partis ou des hommes politiques ainsi qu'avec des hommes d'affaires qui savent comment importer ce dont ils ont le plus besoin – des armes et des munitions – et qui achètent ce qu'ils ont à exporter, en particulier la marijuana et les automobiles volées" (Bayart et al. 1997 : 97).
Il arrive que du bétail, élément essentiel de la culture Basotho, soit volé en Afrique du Sud puis fasse l'objet d'un troc au Lesotho en échange de matekoane, la marijuana locale. A l'inverse, des vaches volées au Lesotho sont échangées pour de la dagga (cannabis en afrikaans) produite en Afrique du Sud. Dans toute la région on peut, semble-t-il, échanger des drogues ou des diamants contre à peu près n'importe quoi, en particulier d'autres marchandises volées, telles que cargaisons de bière, de machines vidéo et de matériel stéréo.
Selon des sources locales d'une région rurale productrice de cannabis du Sud de la Zambie, la production à grande échelle de cannabis destiné à être vendu sur les marchés urbains a été lancée à l'origine par des habitants des villes, venus dans la région pour échanger de la marijuana locale contre des produits de base tels que radios, vêtements, bicyclettes dont les cultivateurs avaient besoin mais qu'ils ne pouvaient trouver dans les boutiques ou qui étaient trop chers pour eux.
Il arrive que les profits découlant des échanges de cannabis soient élevés mais la plupart du temps il n'en est rien parce qu'il s'agit de transactions menées par de petits réseaux d'acteurs locaux sans contact avec le monde extérieur et cet argent parvient alors rarement jusqu'aux banques. Il existe pourtant une variante du troc basée sur des méthodes similaires par laquelle sont blanchis des montants bien plus importants d'argent de la drogue par le biais de leur introduction dans le système bancaire international. Gràce à cette filière, l'argent de la drogue permet d'acheter des biens à haute valeur ajoutée qui, à leur tour, deviennent des monnaies d'échange. Ces produits – or, diamants, métaux non ferreux et dans certains cas, cultures de rapport telles que café et thé – font depuis longtemps l'objet de transactions à forte valeur ajoutée et les réseaux bien huilés par lesquels ils transitent sont souvent protégés par des intérêts nationaux, des personnalités haut placées et aussi des intérêts situés sur d'autres continents, tels que l'Europe et l'Amérique. A titre d'exemple, plusieurs pays africains exportent des diamants alors qu'ils n'en sont pas producteurs. Dans d'autres pays, il y a un écart entre le nombre de carats qu'ils prétendent exporter et les carats effectivement enregistrés à l'importation sur le marché du diamant d'Anvers. La communauté internationale paraît accepter cet état de fait comme une réalité incontournable. Toutefois, sur le terrain d’Afrique australe, les trafiquants de drogue achètent des diamants au marché noir puis les vendent à des négociants patentés qui, en général, achètent des pierres à des producteurs et exploitants de mines indépendants. Le troc est utilisé dans les deux cas mais à des niveaux totalement différents, et il existe une infinité de variantes dans lesquelles un bien à forte valeur ajoutée sert de devise lorsque qu'il fait partie d'une filière ou d'un secteur relativement bien protégé par les services de répression.
Si le cannabis local est surtout utilisé dans les échanges intrarégionaux et pour un blanchiment d'argent relativement minime, la cocaïne, l'héroïne et le Mandrax le sont de plus en plus au sein de vastes systèmes de blanchiment ou pour payer des biens provenant d'Afrique australe, or, diamants, ivoire, cornes de rhinocéros, voire tabac et thé. La carte des activités illicites dressée par l'OGD à partir d'informations recueillies sur le terrain montre clairement que les réseaux de trafiquants de drogue ont emprunté des filières déjà anciennes.
Le paysage sud-africain de la drogue peut se subdiviser en trois grandes "zones d'influence" de l'échange drogues-contre-marchandises régionales, à savoir : la "Côte Est", où prévalent les accords de troc Mandrax/héroïne-contre-or (Maurice, Mozambique et Tanzanie), la "Côte Ouest", zone de la cocaïne-contre-diamants (Angola, Botswana, Namibie et Zimbabwe) et les "pays mixtes" (Lesotho, Malawi, Afrique du Sud, Swaziland et Zambie) qui, pour un certain nombre de raisons, notamment leur situation géographique, les ressources dont ils disposent, l'infrastructure dont ils sont dotés et l'accès de leurs réseaux de trafiquants aux drogues d'"Asie" et de l'"Atlantique", exportent à la fois de l'or et des diamants en échange et de cocaïne et d'héroïne et ou de Mandrax.
Sur la côte Est de l'Afrique australe, les filières de l'héroïne se sont glissées sur les traces des réseaux de contrebande de l'or et de la méthaqualone qui relient l'Afrique à l'Asie du Sud-Ouest via la péninsule arabique. De Zanzibar à Durban, l'Afrique des comptoirs et des ports de l'océan Indien est exploitée par les narcotrafiquants. Ces derniers utilisent les "services" qu'offre l'Afrique australe et bénéficient de ses "ports francs", qui servent de débouchés pour les marchandises exportées à partir de la région côtière orientale et de son arrière-pays depuis l'établissement par les Arabes, autour du XIIe siècle, de comptoirs dans les îles de Zanzibar et de Pemba (qui font aujourd'hui partie de la Tanzanie). De ce fait, la Tanzanie, le Mozambique, Maurice et, dans une moindre mesure, l'Afrique du Sud sont aujourd'hui des pays par lesquels transitent le haschich et l'héroïne venant du sous-continent indien. Par ailleurs, dans les trois premiers de ces pays l'héroïne est devenue la drogue dont le trafic est le plus répandu et qui se vend dans la rue à un prix très modique, comparable aux tarifs de la rue du Pakistan et de l'Inde.
En revanche, le trafic de cocaïne est davantage lié aux routes, réseaux et structures provenant des Amériques (en particulier du Brésil) et d'Europe. Ainsi l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud sont tout autant impliqués dans le trafic international de cocaïne que dans celui des diamants, des armes, des cornes de rhinocéros et de l'ivoire. C'est ce qui explique pourquoi les prix de gros et de vente dans la rue de la cocaïne sont beaucoup plus faibles que ceux pratiqués sur la côte Est et plus proches de ceux qui prévalent dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Ghana, le Nigéria et le Sénégal.
Conclusions
A la lumière de l'analyse qui précède, la soudaine apparition du phénomène de la drogue sur la scène de l'Afrique australe ne paraît plus aussi paradoxale. En fin de compte, les drogues se coulent assez facilement dans les représentations et circuits commerciaux préexistants, à partir desquels se structurent les sociétés de la région. Le présent article donne à penser que les drogues perpétuent plus qu'elles ne bouleversent le fonctionnement des mécanismes sociaux et économiques majeurs, tant à l'intérieur de la région qu'entre cette région et le reste du monde. Eu égard au peu de données empiriques dont on dispose, force est de reconnaître l'incertitude qui entoure cette conclusion, laquelle devra être confirmée par d'autres recherches.
La seule conclusion générale qui découle de ce travail est peut-être qu'une grande partie du discours qualifiant les drogues de "péril planétaire" passe à côté de l'affirmation simple, mais capitale, selon laquelle malgré la mondialisation la terre est peuplée de sociétés dissemblables. Le phénomène de la drogue vient illustrer de façon magistrale la tension existant entre ce qui se produit à l'échelle mondiale et les événements locaux, tension qui caractérise l'actuelle phase de la mondialisation. Il serait plus approprié de parler d'un phénomène "mondiolocal", son incidence à l'échelle planétaire étant à tout moment tributaire de contextes locaux profondément spécifiques et hautement historiques. Par ailleurs, cette incidence globale se traduit différemment selon la situation géographique et le cadre social considéré. Ces contextes locaux historiques et la façon dont ils interagissent avec les contextes planétaires expliquent, notamment, la formation et la répartition de ce "capital de protection" qui confère l'impunité requise pour exécuter la plupart des activités liées à la drogue.
De plus, il semble que le caractère "mondiolocal" actuel des drogues provienne en grande partie de la nature répressive de la prohibition. En réalité, si l'interdiction des drogues peut aujourd'hui être véritablement qualifiée de mondiale, étant donné que le système juridique d'interdiction est construit sur le même modèle dans la plupart des Etats, il n'en reste pas moins que, dans les faits, elle n'est pas appliquée partout de façon uniforme.
Traduit de l’anglais
Références
AMUPADHI, T. et COMMANDEUR, M. 1997. "Searching for a ‘guilty’ Nigerian". Johannesbourg : The Weekly Mail and Guardian, 18 avril.
BAYART, J.F, HIBOU, B. et ELLIS, S. 1997. La criminalisation de l’Etat en Afrique. Paris : Complexe.
DEPARTMENTS OF CORRECTIONAL SERVICES, DEFENCE, INTELLIGENCE, JUSTICE, SAFETY AND SECURITY, AND WELFARE 1996. National Crime Prevention Strategy. Pretoria.
GEFFRAY, C. 1996. Situation du commerce illégal de la cocaïne dans le Mato Grosso : circulation de cocaïne et troc des richesses volées à la frontière bolivienne. Rapport d'activité n° 2. Mimeo.
GOOTENBERG, P. (dir. publ.) 1999. Cocaine: Global Histories. New York : Routledge.
HUNTINGTON, S. 1993. "The Clash of Civilizations", Foreign Affairs, vol. 72, n° 3.
KEH, D. et FARREL, G. 1997. "Trafficking Drugs in the Global Village", Transnational Organized Crime, vol.3, n° 2.
OGD 2000. La géopolitique mondiale des drogues. 1998/1999, Paris : OGD.
PNUCID 1997. Rapport mondial sur les drogues. Oxford : Oxford University Press.
ZINBERG, N. 1984. Drug, Set, and Setting: The Basis for Controlled Intoxicant Use. New Haven : Yale University Press.
NOTES