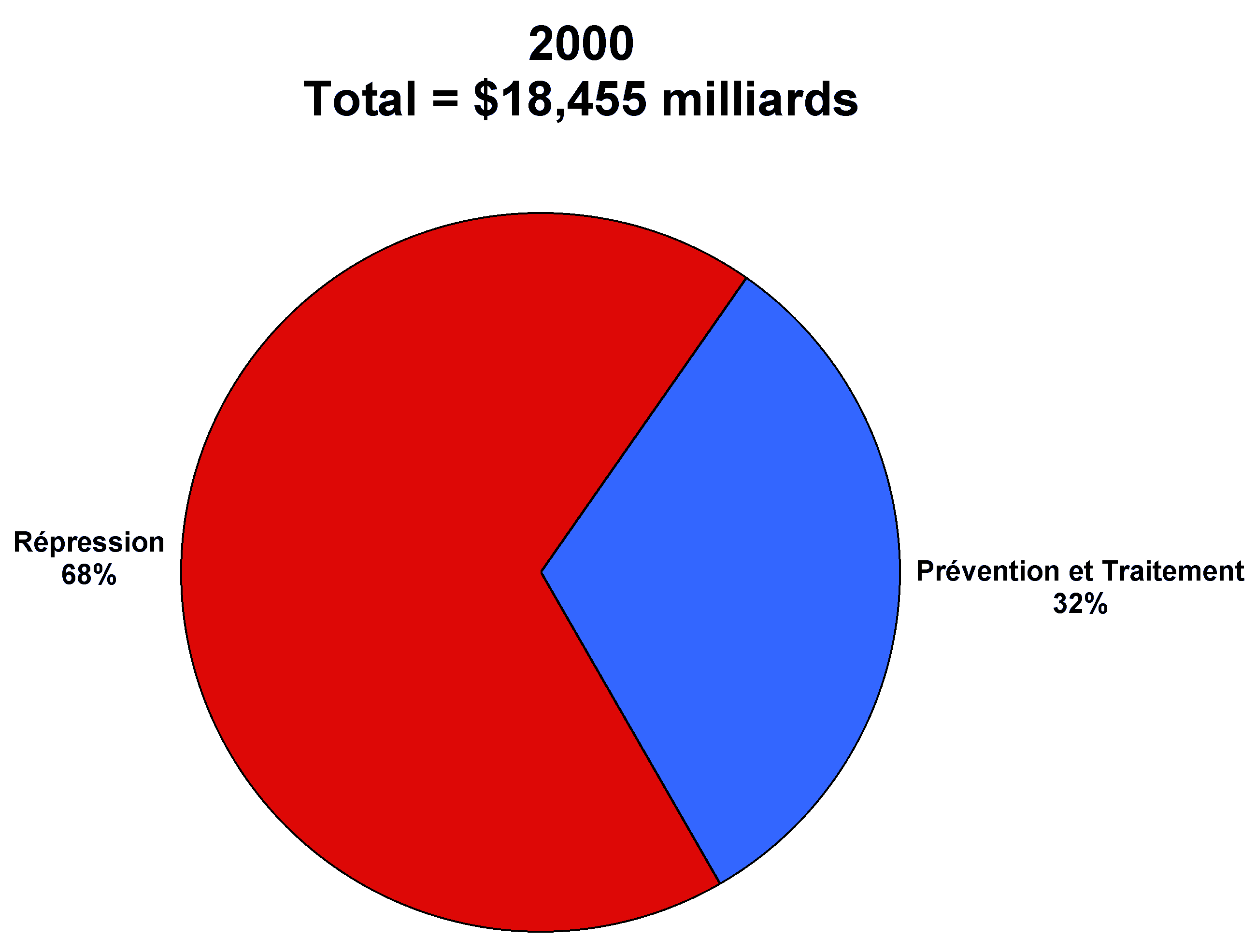Communauté des sciences sociales et politique antidrogue aux États-Unis
Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (CEMOTI), dossier "Drogue et Politique" (coord. P-A Chouvy & G. Aureano), N° 32, 2001.
Introduction[1]
Les relations entre le phénomène de la drogue et la politique à l’époque contemporaine ont été étudiées à partir de points de vue aussi nombreux que variés. Toutefois, il existe très peu d’études traitant du point de vue des sciences sociales sur les politiques publiques de la plus grande puissance mondiale en matière de drogues illégales. Le présent travail se propose de commencer à remplir ce vide en proposant un bref panorama des relations entre la recherche en sciences sociales et les politiques dites de « contrôle des drogues » (drug control) des États-Unis d’Amérique.
Les États-Unis, qui ont inspiré, dès le début du XXe siècle, le régime de contrôle des drogues actuellement en vigueur au niveau international (ONU) et dans un très grand nombre de pays, sont encore son principal soutien en ce début du XXIe siècle. Les États-Unis sont à la fois le plus grand producteur de recherche en sciences sociales sur la drogue et la seule « superpuissance antidrogue » de la planète. Toutefois, ce double leadership ne résulte pas d’une relation symbiotique entre les deux champs des sciences sociales et de la politique, bien au contraire. On note, en effet, une profonde insatisfaction de la recherche avec les politiques mises en ìuvre, accompagnée d’un désintérêt des politiciens pour les résultats de la recherche.
Alors que les décideurs se basent sur des notions relevant de la « sagesse conventionnelle » (conventional wisdom), telle que définie par Galbraith, soit « la structure des idées basée sur l’acceptabilité », les chercheurs ont été amenés à considérer les politiques gouvernementales et les dynamiques qu’elles engendrent ou dont elles sont les produits comme un aspect central du « problème de la drogue » dans leur pays. Ainsi, les livres et les articles traitant de la politique sont bien plus nombreux aux États-Unis que les études des mécanismes de fonctionnement du trafic de drogues illégales.
Pour illustrer cette tension entre recherche et politique, nous allons nous intéresser brièvement à l’un des aspects des politiques antidrogue les plus critiqués par les sciences sociales américaines actuelles : le lien problématique entre drogues et criminalité qui sous-tend les politiques contemporaines.
Notons au passage que nous ne nous intéresserons ici qu’à certains aspects des politiques intérieures, non seulement parce que nous manquons de place pour aborder la politique étrangère, la « narco-diplomacy » comme on l’appelle aux États-Unis, mais aussi parce que cette dernière nous semble être une adaptation au contexte étranger des conceptions mises en ìuvre dans le cadre interne. D’après nous, les différences entre politique intérieure et politique étrangère américaine de contrôle des drogues, si tant est qu’on puisse démontrer qu’elles existent, sont d’ordre circonstanciel et non essentiel[2].
I. Double leadership : quelques éléments d’interprétation
Depuis plus de cent ans, les « narcotics », comme les Américains aiment à se référer aux substances illégales, même lorsque celles-ci ne provoquent pas d’assoupissement, ont fait l’objet de politiques publiques et attiré l’attention des chercheurs. Ainsi, les États-Unis sont sans doute aujourd’hui le plus grand producteur de sciences sociales sur les drogues illégales dans le monde. Ce leadership s’explique par des facteurs « physiques » : les États-Unis sont l’un des plus grands pays du monde, ils possèdent de nombreuses universités et un grand nombre de centres de recherche gouvernementaux et indépendants, ainsi que diverses fondations privées. De plus, comme les drogues constituent une préoccupation de politique intérieure et étrangère de premier plan, et un sujet de débat idéologique et politique, les financements de recherche ont été comparativement plus généreux que dans d’autres pays, même si nombre des chercheurs interrogés ont déclaré qu’ils n’étaient pas faciles à obtenir.
D’autres facteurs, expliquant à la fois l’abondance de la recherche et sa forte concentration sur les politiques publiques, résultent des particularités de la démocratie américaine. En effet, bien que diverses zones d’ombre persistent du fait de la « sécurité nationale » (le secret défense des Américains) et de la raison d’État, la politique se prête plus facilement à la recherche parce qu’elle est publique et qu’elle génère beaucoup de documentation officielle sur laquelle des études peuvent s’appuyer. Le droit d’accès aux documents officiels est pris bien plus au sérieux aux États-Unis que dans la plupart des autres pays. La responsabilité envers les citoyens (public accountability) est un aspect central de la démocratie américaine, et les citoyens, c’est à dire les contribuables qui financent le gouvernement, ont le droit de savoir ce que qu’on fait de leur argent. La Loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act, FOIA) constitue un garde-fou contre la confidentialité excessive des actions gouvernementales. Aussi le gouvernement produit-il de nombreux documents expliquant et justifiant ses actions, et il prend soin de les rendre facilement accessibles au public. Par exemple, une très grande quantité de documentation américaine officielle est disponible sur Internet. L’argent est également une des raisons essentielles de la concentration des chercheurs sur la politique. En effet, le gouvernement fédéral consacre plus de 10 milliards de dollars par an au contrôle des drogues depuis de longues années, et une somme au moins équivalente est dépensée par les autres niveaux de gouvernements : les États, les comtés et les municipalités. Actuellement, pas moins de 52 agences fédérales participent à l’effort fédéral de contrôle, et chacune d’entre elles doit justifier son budget. Le partage du « fromage » que constitue le budget antidrogue, c’est à dire l’affectation annuelle des fonds par le Congrès, donne lieu à un débat public et bureaucratique où des arguments sont produits afin de soutenir les demandes de financement. Les arguments avancés par l’énorme bureaucratie antidrogue américaine afin d’obtenir des fonds, cette mécanique bureaucratique elle-même et son impact à la fois sur les politiques suivies et sur leur mise en pratique, ont donné lieu à de nombreuses recherches. Ceci s’insère dans une tradition qui remonte aux origines mêmes des États-Unis. Les pères de la Constitution américaine avaient pour principal souci de se prémunir contre l’avènement d’une forme oppressive (de type européen) de gouvernement. La Constitution cherche ainsi à garantir la liberté individuelle (Liberty) par l’établissement de contrôles et d’équilibres entre les pouvoirs (checks and balances) ainsi que leur séparation. En outre, les écrits du philosophe britannique John Stuart Mill exercent une grande influence sur la pensée américaine. Mill se méfiait de la bureaucratie, dont il pensait qu’elle tendait à mettre ses activités officielles – de service public – au service exclusif de sa propre reproduction[3].
La suspicion envers les activités du gouvernement et de la bureaucratie en général nous semble aussi répandue au sein de la communauté des sciences sociales américaines que dans la société en général, et les Américains ressentent le besoin de les maintenir sous contrôle. D’une certaine façon, sous prétexte d’une quête de rationalité, la recherche concernant la politique antidrogue constitue probablement l’une des meilleures illustrations actuelles de cette suspicion.
II. Le problème carcéral
A. Ampleur du problème
L’intérêt critique que les chercheurs portent aux politiques antidrogue actuelles est en grande partie motivé par la croissance extraordinaire de la population carcérale américaine. Dans une large mesure, cette croissance est due aux lois antidrogue fédérales adoptées depuis le milieu des années 1980 à l’initiative des administrations Reagan (1986) Bush (1988) et Clinton (1994) et à des lois d’État similaires dont l’origine remonte à 1973 avec l’adoption des Rockefeller Drug Laws dans l’État de New York.
D’après la National Drug Control Strategy de l’Office of National Drug Control Policy, (ONDCP), le bureau du « Tsar antidrogue », les prisons américaines détenaient 1 725 842 personnes en juin 1997 ; ce chiffre est d’environ 2 millions à la mi-mai 2001[4]. En 1991, selon le chercheur Marc Mauer, les États-Unis possédaient le plus fort taux d’incarcération au monde, surpassant la Russie et l’Afrique du Sud. Depuis, la Russie est passée première et les États-Unis deuxièmes, comme le montre le tableau suivant[5] :
Tableau 1. Population carcérale et taux de personnes emprisonnées pour 100 000 habitants dans quelques pays, 1992/1993
| Pays |
Nombre total de prisonniers |
Taux de prisonniers pour 100 000 habitants |
| Fédération de Russie |
829 000 |
558 |
| États-Unis |
1 339 695 |
519 |
| Afrique du Sud |
114 047 |
368 |
| Singapour |
6 420 |
229 |
| Canada |
30 659 |
116 |
| Angleterre et Pays de Galles |
53 518 |
93 |
| Espagne |
35 246 |
90 |
| Brésil |
124 000 |
84 |
| France |
51 457 |
84 |
| Japon |
45 183 |
36 |
| Inde |
196 221 |
23 |
Source : Mauer, Marc, Americans Behind Bars: A Comparison of International Rates of Incarceration, Washington, The Sentencing Project, 1994, Table 1., p. 2.
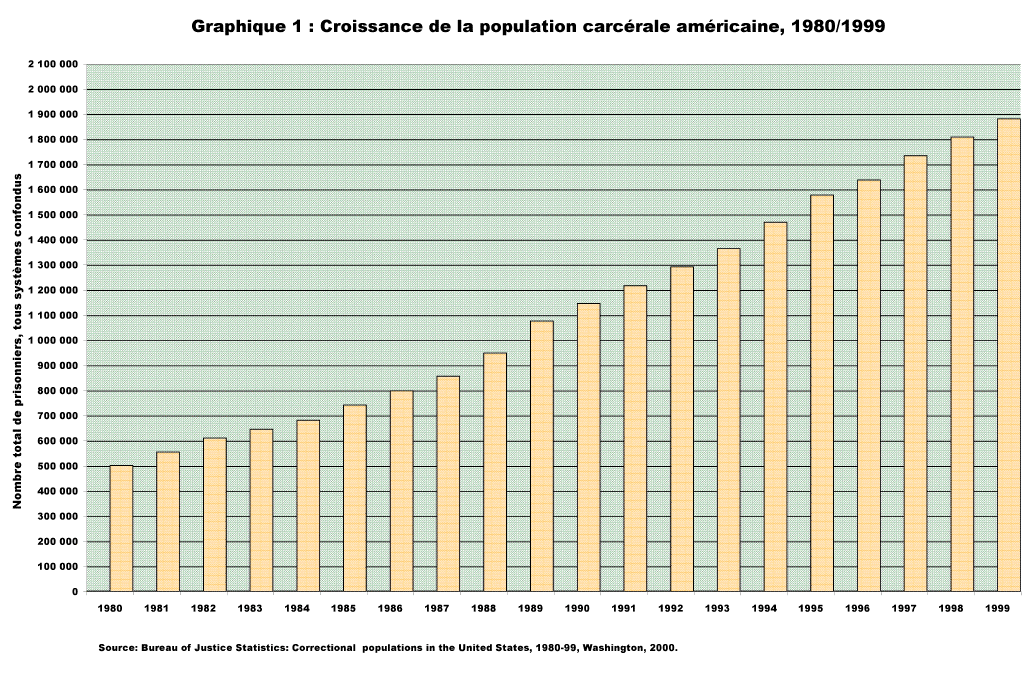
Entre 1985 et 1995, les infractions aux lois antidrogue ont fourni 75% de la croissance de la population carcérale fédérale. Au niveau national, environ 25% des prisonniers sont détenus pour infractions aux lois antidrogue (voir Graphique 2, infra), mais 60% des détenus fédéraux sont incarcérés pour une infraction à ces mêmes lois. Parallèlement, « le nombre des personnes détenues dans les prisons d'État du fait de violations aux lois sur les drogues a augmenté de 487% [entre 1985 et 1995]. »[6] Ce sont les prisons des États qui, collectivement, accueillent le plus de prisonniers.
Graphique 2 : Distribution de la population carcérale des États par infraction la plus grave, 1980 et 1996
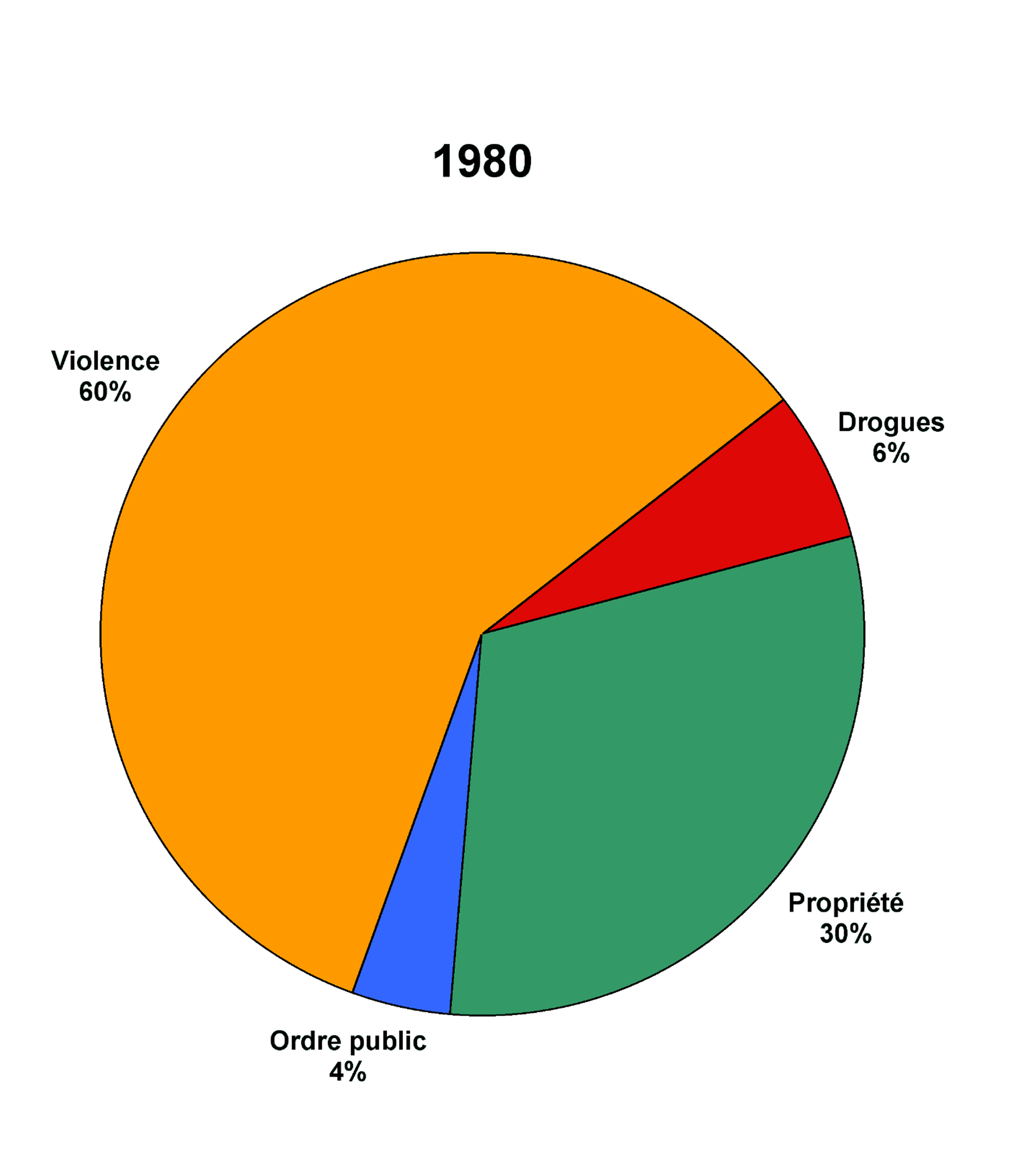
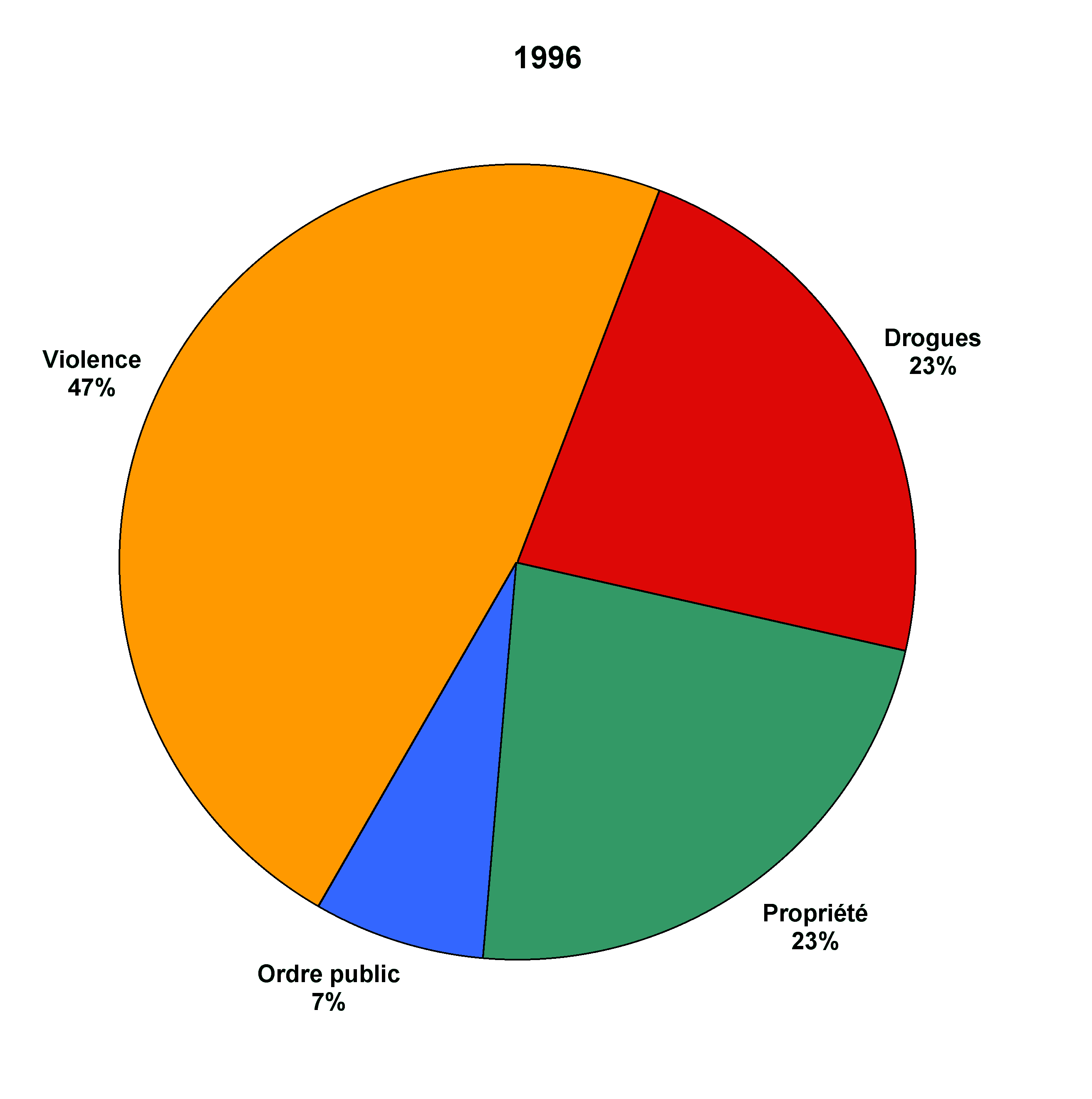
Source : Bureau of Justice Statistics: Correctional Populations in the United States, 1996, Washington, 1997, Table 1.13.
Même s’il souligne qu’« alors que la criminalité en général continue de diminuer, les arrestations pour violation des lois fédérales sur la drogue atteignent une ampleur inégalée », le gouvernement mentionne les prodigieuses statistiques carcérales américaines au titre des « conséquences en termes de criminalité » du « problème de la drogue en Amérique » et affirme que « de nombreux crimes sont commis sous l’influence de la drogue ou pourraient avoir pour motif le besoin de trouver de l’argent pour acheter des drogues » (infra).
Depuis 1980, les États-Unis ont construit plus de prisons et incarcéré plus de gens qu’à n’importe quelle autre époque de leur histoire. Malgré ces investissements massifs au niveau fédéral et à celui des États – qui ont donné naissance, d’après certains journalistes et chercheurs, à un « complexe carcéro-industriel » ou à un « goulag occidental »[7] – le système pénal américain est engorgé. Les conditions de détention sont souvent médiocres et ont donné lieu à des abus des droits de l’homme dénoncés à maintes reprises par des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch[8].
Cette croissance et ces problèmes résultent dans une large mesure de lois de détermination de la peine (sentencing laws) adoptées durant les 25 dernières années, notamment les lois dites de « peines minimales obligatoires » (mandatory minimum laws) aujourd’hui en vigueur au niveau fédéral et dans tous les États. Ces lois imposent que certaines infractions, en particulier les infractions-drogues, soient punies de peines de prison (au détriment d’autres formes de sanction), et la plupart stipulent un nombre minimum d’années d’emprisonnement. Dans de nombreux États, et notamment dans celui de New York qui, en 1973, a été le premier à mettre en place ce type de lois pour punir des infractions-drogues, le minimum obligatoire pour des infractions-drogues, toutes classifiées comme non-violentes, est équivalent, et parfois supérieur, à celui de crimes violents comme le meurtre et le viol. Ces lois enlèvent aux juges tout pouvoir discrétionnaire et les obligent à imposer le minimum requis par la loi sans tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes. Un juge fédéral a déclaré à propos de ces lois : « il est difficile de croire que la possession d’une once de cocaïne ou qu’une vente de rue à 20 dollars est une infraction plus dangereuse ou plus grave que le viol d’un enfant de 10 ans, l’incendie volontaire d’un immeuble occupé ou l’assassinat d’un autre être humain résultant de la volonté de lui causer des blessures graves. »[9] Ainsi, actuellement, à New York, tout adulte condamné pour la possession de 4 onces de cocaïne (113 grammes) ou la vente de 2 onces doit être soumis à une peine minimum de 15 ans de prison et risque la perpétuité (15 years to life).
Dans la plupart des États, l’objectif officiel de l’emprisonnement n’est plus de réhabiliter le condamné mais de le punir, d’où l’appellation, qui ne doit rien au second degré ou à la métaphore, de « lois punitives » (punitive laws) pour décrire ce type de législation.
Certaines de ces lois ont été critiquées par les organisations de défense des droits de l’homme car elles violent diverses conventions internationales, dont celle contre la torture, car elles sont considérées comme « cruelles et inusuelles ». Les chercheurs les ont critiquées comme coûteuses et inefficaces pour lutter contre la drogue, dans la mesure où elles n’ont permis que l’emprisonnement de petits dealers... qui sont immédiatement remplacés dans la rue. Ainsi, une étude de la Rand Corporation a conclu : « le rapport existant entre le coût des peines minimales et leur efficacité à réduire la consommation de cocaïne, les dépenses occasionnées par la cocaïne et la criminalité liée à la drogue ne permet pas d’en justifier l’existence »[10]. Pour prendre un autre exemple significatif, John Dilulio, un criminologue conservateur qui se définit lui-même comme « l’un des rares universitaires favorables à l’emprisonnement », a écrit dans la National Review, un magazine politique conservateur : « les peines minimales obligatoires n’entraînent pas de véritable éradication du trafic de drogues et elles ne permettent qu’épisodiquement aux auteurs de seules infractions-drogues [drug-only offenders] de bénéficier de traitement lors de leur incarcération ; donc, l’imposition de peines de prisons – obligatoires ou non – à ce type de personnes est très difficilement justifiable en termes de contrôle de la criminalité. »[11] Une étude de Human Rights Watch sur l’impact des peines minimales obligatoires sur les auteurs d’infractions mineures aux lois antidrogue conclut que ces lois violent « la dignité inhérente aux personnes, le droit à ne pas être soumis à des punitions cruelles et dégradantes et le droit à la liberté ». Le rapport de 1997 ajoute que « de telles peines contreviennent à la déclaration universelle des droits de l’homme, à la Convention internationale sur les droits civiques et politiques et à la Convention contre la torture et autres punitions et traitements cruels, inhumains ou dégradants »[12].
Un problème similaire est créé par les lois dites de « three strikes and you’re out », qui entraînent automatiquement une très longue peine d’emprisonnement (en général, un minimum de 25 ans, voire la perpétuité) à la troisième condamnation pour un délit grave (les infractions aux lois antidrogue sont considérées comme des délits graves, ou felonies). Utilisées dans le cadre de la « Guerre à la drogue », ces lois ont également grandement contribué à l’explosion de la population carcérale américaine, par exemple en Californie où une loi de « three strikes » particulièrement dure a été adoptée en mars 1994[13]. La Californie possède le système carcéral le plus peuplé des États-Unis et l’un des plus vastes au monde.
B. Disparité raciale
Un autre phénomène lié à l’explosion de la population carcérale est ce que Troy Duster appelle « l’assombrissement des prisons américaines »[14], c’est à dire le fait que les Hispaniques et surtout les Noirs américains sont beaucoup plus incarcérés que les Blancs. En 1993, le taux d’incarcération des Noirs (1 471 pour 100 000) était sept fois supérieur à celui des Blancs (207 pour 100 000). En 1994, les Noirs américains ne représentaient que 12% de la population des États-Unis mais fournissaient 44% des détenus des prisons fédérales et des États ; les Hispaniques (10% de la population) fournissaient 18% de ces prisonniers ; les Blancs (74% de la population) constituaient 39% de cette population carcérale[15]. Comme le suggère le Graphique 3 (infra), la tendance à « l’assombrissement » s’est poursuivie après 1994. En fait, les Noirs de toutes les origines fournissent plus de la moitié des personnes emprisonnées aux États-Unis. L’incarcération massive des Noirs, due dans en grande partie aux lois antidrogue, tend à réduire leur poids électoral, notamment dans les grands États du sud, comme le Texas et la Floride[16].
Enfin, notons que, depuis quelques années, la population carcérale féminine augmente plus vite que la moyenne et que c’est le taux d’incarcération des femmes noires qui augmente le plus rapidement[17].
Cette sur-représentation des Noirs dans la population américaine est attribuable, dans une certaine mesure, aux effets discriminatoires des lourdes peines imposées aux personnes condamnées au niveau fédéral pour association avec le crack (crack cocaine). Pour le système juridique américain, le crack et le chlorhydrate de cocaïne, ou cocaïne en poudre (powder cocaine), sont « deux formes de la même drogue » car, dans les deux cas, c’est le même alcaloïde qui est l’ingrédient actif. Mais le crack est considéré comme une drogue extrêmement dangereuse, aux effets individuels et sociaux plus dévastateurs que la poudre, et, de ce fait, les lois antidrogues fédérales de 1986 et de 1988 (Anti-Drug Abuse Acts) ont fixé des peines minimales obligatoires beaucoup plus lourdes pour le crack que pour la poudre. Ainsi, toute personne condamnée pour la possession de 5 grammes de crack ou plus doit purger une peine de 5 ans de prison. Dans le cas de la poudre, c’est la possession de 500 grammes ou plus qui entraîne une peine minimale obligatoire de 5 ans d’emprisonnement. De même, la possession de 50 grammes de crack entraîne une peine obligatoire de 10 ans au minimum, alors que c’est la possession de 5 kilogrammes de poudre qui entraîne obligatoirement une peine de 10 ans. Il existe donc une disparité de 1 à 100, à la défaveur des personnes impliquées dans le crack, entre les quantités entraînant des peines de même longueur. En d’autres termes, il faut être pris avec 100 fois plus de cocaïne en poudre que de crack pour se voir condamner à la même peine minimale obligatoire de 5 ou 10 ans d’emprisonnement.
En outre, à partir de 1988, la simple possession (sans intention de cession) de 5 grammes ou plus de crack par un(e) non-récidiviste (first-time offender) entraîne, toujours au niveau fédéral, une peine minimale obligatoire de 5 ans d’emprisonnement, alors que la simple possession par un(e) non-récidiviste d’une telle quantité de n’importe quelle autre drogue illégale (héroïne et cocaïne en poudre y comprises) est considérée comme un délit mineur (misdemeanor offense) puni d’un an de prison au maximum.
L’effet discriminatoire en défaveur des Noirs de cette disparité entre crack et poudre, maintes fois dénoncé aux États-Unis[18] et reconnu comme tel par la United States Federal Sentencing Commission (une agence, appartenant au Congrès qui a voté ces lois, chargée de faire des recommandations en matière de peines), est dû à trois facteurs principaux, dont les effets se conjuguent et se renforcent mutuellement. D’abord, la cocaïne en poudre est beaucoup plus consommée par les Blancs que par les Noirs. Ainsi, d’après les données collectées dans le cadre officiel du National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA) effectué 1991, 75% des utilisateurs de poudre sont blancs et 15% sont noirs. En ce qui concerne le crack, la disparité est moindre : 52% des utilisateurs de crack sont blancs et 38% sont noirs, toujours d’après le NHSDA de 1991[19]. Les Noirs ont donc statistiquement beaucoup plus de chances que les Blancs d’être arrêtés, puis condamnés, pour possession de crack. D’autant que – et c’est la deuxième explication – la cocaïne en poudre est beaucoup plus chère que le crack. Le crack est habituellement vendu au détail en doses de 0,1 à 0,5 grammes coûtant entre 5 et 20 dollars ; en revanche, la poudre est généralement détaillée au gramme ou au demi-gramme au prix de 65 à 100 dollars le gramme. Or, les Noirs sont généralement plus pauvres que les Blancs et il est donc statistiquement moins probable qu’ils aient accès à la cocaïne en poudre qu’au crack. En 1998, d’après le Bureau du recensement du gouvernement fédéral, 26,1% des Noirs, mais seulement 8,2% des Blancs, étaient officiellement considérés pauvres aux États-Unis[20]. Enfin, les lois sur la cocaïne punissent beaucoup plus sévèrement les vendeurs de crack au détail (c’est à dire les petits dealers) que les grossistes ou les importateurs de cocaïne en poudre (les gros trafiquants), c’est à dire ceux qui fournissent la matière première servant à la fabrication du crack[21]. Et, aux États-Unis comme dans le reste du monde, on sait qu’il est beaucoup plus aisé pour la police d’arrêter, et pour la justice de condamner, les petits dealers que les gros trafiquants. Ainsi, les 5 grammes de crack entraînant une peine minimale obligatoire de 5 ans de prison ne représentent que 10 à 50 doses pouvant rapporter au détail de 225 à 750 dollars (de 1 650 à 5 450 francs français). En revanche, les 500 grammes de poudre entraînant la même peine minimale obligatoire de 5 ans de prison représentent 500 à 1 000 doses, soit de 32 500 à 50 000 dollars (de 237 250 à 365 000 francs français)[22].
Résultat : en 1993, 88,3% des personnes condamnées pour possession ou trafic de crack étaient noires et 4,1% blanches (pour la poudre : 39,3% noirs, 32% blancs). La Federal Sentencing Commission conclut donc que « les données concernant les peines imposées au niveau fédéral appellent inévitablement la conclusion que les Noirs représentent la plus grande proportion des personnes touchées par les peines associées au crack »[23].

NB : Du fait que la catégorie des « Hispaniques » contient des personnes de race noire (par exemple des Dominicains noirs), les Noirs de toutes origines constituent plus de 50% de la population carcérale.
III. Politiques punitives et recherches
A. Justification officielle des politiques punitives
Étant donné son rôle dans les politiques de contrôle actuelles et l’impact de la législation antidrogue dépeint dans les paragraphes précédents, les relations qu’entretiennent les drogues et la criminalité ont fait l’objet de nombreuses recherches. En effet, « l’ascendant des faucons », comme dit Peter Reuter[24], sur les politiques antidrogue depuis une quinzaine d’années a été grandement justifié et légitimé par le présupposé que les dealers et consommateurs de drogues sont des êtres méprisables qui infligent des dommages importants à la société et qui, donc, méritent d’être traités avec la plus grande sévérité. Pour simplifier, les politiques punitives, basées sur la théorie du choix rationnel, sont justifiées de la manière suivante : les drogues poussent leurs utilisateurs à priver violemment autrui du droit de jouir librement de la vie et de la propriété privée ; les individus font un choix personnel lorsqu’ils prennent des drogues et doivent donc être tenus pour personnellement responsables de ce choix et de ses conséquences pour autrui ; l’emprisonnement constitue une punition adéquate, surtout parce qu’il dissuade (c’est du moins ce qu’affirme la théorie punitive) les usagers potentiels de devenir des usagers effectifs. Ceux qui fournissent des drogues, et donc qui en poussent d’autres à commettre des crimes tout en réalisant des profits, méritent une punition encore plus sévère car ils sont les vecteurs du « fléau de la drogue » (drug scourge). Le passage suivant, extrait des attendus d’une décision de la Cour suprême fédérale de 1969, illustre cette perspective :
« Le trafic commercial des substances mortelles qui détruisent l’esprit et l’âme est sans l’ombre d’un doute l’un des plus grands maux de notre époque. Il mutile l’intellect, rabougrit le corps, paralyse le progrès de segments substantiels de notre société et transforme fréquemment les personnes de tous âges qui en deviennent les victimes en criminels irrécupérables et parfois violents et meurtriers. De telles conséquences appellent l’adoption des lois les plus rigoureuses pour supprimer le trafic et les efforts les plus énergiques pour faire appliquer ces lois rigoureuses. » [25]
Cette approche basée sur « la loi et l’ordre » a été entérinée par les deux grands partis représentés au Congrès depuis le milieu des années 1980, et c’est elle qui justifie que près de 70% du budget fédéral alloué à la lutte antidrogue, tant aux États-Unis qu’outre-mer (soit près de 18,5 milliards de dollars en 2000), soit affecté à la répression.
B. La recherche sur les liens entre drogues et criminalité
Il n’est pas possible de rendre compte ici de l’ampleur et de la diversité des recherches sur le lien entre drogues et criminalité effectuées aux États-Unis, ne serait-ce que durant les dix dernières années. Mais on peut tenter de l’illustrer en analysant un problème qui a beaucoup occupé les chercheurs : les effets des drogues sur le comportement criminel. On présume en général que les usagers de drogues commettent des crimes de façon récurrente et habituelle afin de financer leur consommation. La « sagesse conventionnelle » présuppose également que lorsque les gens sont sous l’influence de drogues, ils perdent leurs inhibitions et commettent des crimes, et en particulier des violences. Ces notions sont à l’origine des politiques actuelles qui rendent la consommation et le trafic de drogues – et non, par exemple, la pauvreté – responsables des forts taux de criminalité existant aux États-Unis. Il est fréquent que des élus et des hauts fonctionnaires fassent appel à ces notions lors de discours, notamment télévisés, destinés à susciter le soutien de l’opinion publique pour la « Guerre à la drogue »[26]. Un exemple fameux est le discours télévisé du président George Bush du 5 septembre 1989. Brandissant un sachet de crack, dont il affirma qu’il avait été « saisi dans un parc en face de la Maison Blanche », Bush déclara : « le crack est en train de transformer nos villes en champs de bataille et d’assassiner nos enfants », et annonça sa stratégie pour remporter « la victoire sur les drogues »[27].
IV. L’environnement socioculturel : concept central du débat américain
Conclusion[46]